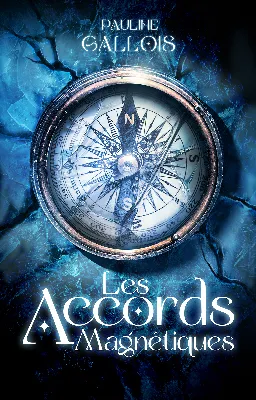J'ouvre les yeux avec difficulté et étire mon corps raide comme une vieille planche. Je ne sais pas quelle heure il peut bien être mais un filet de jour se glisse par les hublots de la soute. J'entends des bruits de couvert et la rumeur de conversation dans la pension où les marins prennent leurs repas.
Étrange.
D'habitude je me réveille sous les coups de pieds de Brébant ou parce qu'un matelot a jugé amusant de retourner mon hamac pour que je m'étale sous les quolibets de la moitié de l'équipage.
Prudemment, je me glisse hors de ma couche, alerte au moindre piège. Peut-être qu'il s'agit encore d'un mauvais coup à mon intention. Peut-être qu'ils veulent me voir baisser ma garde pour mieux me rouler ensuite.
Mais je ne vois rien de suspect. A part un tas de vêtements secs posés sur le coffre qui m'est attribué. Il y a même un bonnet de laine épaisse.
Je profite que les quartiers soient vides pour me débarrasser de ma chemise encore toute humide de la veille et je soupire d'aise en sentant le tissus sec et tiède contre ma peau.
— Bien dormi ?
Je sursaute et fait volte-face pour croiser le regard de Joseph, allongé sur sa couchette, les bras derrière la nuque. Sa jambe nue, gonflées et bleue est toujours emprisonnée entre deux planches et son front disparait sous un bandage qui lui fait une drôle de tête. Son petit sourire s'élargit et mes doigts terminent de boutonner la chemise. Mon expression doit refléter mon malaise car il ajoute :
— J'ai demandé qu'les gars te fichent la paix pour c'matin. Mais va pas croire qu'ce s'ra tous les jours comme ça.
— Merci.
— Va manger un bout. La mer est calme aujourd'hui. Poret et Leroy terminent d'inspecter les dégâts.
Je file sans me faire prier. Je ne sais pas ce qu'il a eu le temps d'apercevoir lorsque je me suis changée. Je vais devoir redoubler de prudence. Dans la pension, Joseph et plusieurs autres gabiers sont attablés et m'accueillent avec des hochements de têtes. Le maître coq, un vieux marin maigre comme un clou et presque aussi silencieux me sert un bol de gruau blanchâtre.
J'ai appris à ne plus faire la fine bouche. La faim fait gronder mon ventre et je dévore à toute allure, comme si je craignais qu'on me vole mon écuelle.
Ce qui n'est pas si loin de la vérité.
Les hommes me contemplent en buvant leur bière d'un air amusé et lorsqu'on place une chope devant moi, je la mets de côté. Je l'apporterai à Jacques plus tard. Je n'ai pas oublié ma promesse.
— Va falloir déferler la toile aujourd'hui, décrète Joseph.
J'ignore s'il s'adresse à moi en particulier et je m'arrête, la bouche encore pleine. Je dois avoir l'air d'un animal craintif car les autres gabiers se mettent à ricaner.
Joseph sourit et sort deux bouts de corde de quelques pouces qu'il place devant moi.
— Noeud de chaise, cabestan et nœud de ris. Montre-moi.
Je déglutis. Tout le monde m'observe et je sais que je suis en train de passer une sorte d'examen. J'ignore en revanche ce qu'il se passera si j'échoue, alors je m'empare des deux bouts et les enroules comme Brébant me l'a appris.
Le nœud de chaise est le plus facile. J'en ai effectué tant à bord depuis ces deux dernières semaines que mes doigts savent bien avant mon esprit comment faire. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir.
Cabestan. Cette fois je vais plus lentement, j'hésite. Ce nœud n'est pas compliqué, mais je n'ai pas beaucoup eu d'occasion pour le pratiquer. Il glisse dès qu'une corde n'est plus en tension et avec des bouts de corde mous comme ceux que je tiens, ce n'est pas évident de me souvenir des enchaînements.
Noeud de ris. Je m’arrête pour invoquer les souvenirs de la nuit. Je ne parviens pourtant qu’à me rappeler la violence des vagues, le piquant de l'eau de mer dans ma gorge et la hauteur vertigineuse du mât de misaine. Je revois les mains de Brébant enrouler les cordages mais tout est flou, assourdis par la tempête. Noeud de ris. Mes doigts hésitent, s'embrouillent. Les deux cordelettes retombent sur la table.
Je me crispe et fait le dos rond. Je m’attends à des railleries ou à une claque à l'arrière de mon crâne comme Brébant en avait l'habitude.
Rien ne vient. Joseph se contente de reprendre les cordes et de les enrouler lentement sous mes yeux. Deux clés, imbriquées l'une dans l'autre.
— Tu vois ? ajoute-t-il. Solide quand on tire dessus, mais il suffit de toucher ici...
Il saisit une des terminaisons du nœud qui se délite en un clin d'œil.
Timide, je demande.
— Est-ce que tu pourrais...
Joseph comprend sans que j’aie besoin de terminer et réitère la manœuvre sous mon regard concentré.
Un autre gabier intervient alors :
— Montre-lui le nœud de carrick.
Joseph hoche la tête et se met à enrouler les cordes avec une dextérité surprenante. J'ai du mal à comprendre comment des mains si épaisses, burinées et couverte de cals parvient à tresser avec tant d'agilité. La corde forme un motif entrelacé élégant.
— Pour relier deux bouts, explique Joseph. Essaie.
***
J'ai beau avoir expérimenté l'ascension des mâts dans des conditions extrêmes, je peine malgré tout à évoluer dans les hauteurs. Les muscles de mes bras me font un mal de chien et le vertige ne me quitte pas.
Joseph affirme que c'est comme le mal de mer, d'ici quelques jours, cela passera. J'ai du mal à le croire. Je m'entraîne à marcher sur les vergues, à vérifier que les drisses ne sont pas grippées et à passer d'un mât à un autre sans toucher le pont, même quand il n'y a pas de manœuvres.
L'équipage trouve cela amusant au début, et certains me prodiguent des conseils depuis le pont tout en fumant leurs pipes, mais au bout de trois jours mes petites acrobaties les ennuient et ils préfèrent se retrouver dans la pension, au chaud et au sec pour jouer aux cartes pendant leurs quartiers libres.
Il faut dire que les températures se font de plus en plus fraîches, et les jours de plus en plus longs. Le navire file plein nord et malgré la saison estivale, il m'arrive de trouver une fine pellicule de givre sur les cordages au petit matin.
Ce matin, je me suis perchée sur la hune pour admirer les couleurs du ciel. Je n'arrive pas à dormir à cause du jour qui se lève dès quatre heures du matin.
Le bateau est calme à cette heure-ci. Il n'y a qu'une petite équipe de matelots qui s'occupe de tenir la barre sur le gaillard arrière et de rectifier notre trajectoire.
J'observe le sillage blanc mousseux que laisse notre vaisseau derrière lui puis la mer sous l'horizon rose et or. Des nuages serpentent, teintés d'aurore, comme si des navires volants sillonnaient le ciel en parfait échos à notre course. Je resserre ma veste autour de moi en réprimant un frisson et un bâillement.
Mon regard retombe sur le pont et sur le gaillard d'avant où les trois focs claquent gaiment dans la brise. Puis je l'aperçois.
Ce n'est pas lui que je vois en premier, à vrai dire, mais plutôt la lente danse de la magie. Elle ondule, tourne et se rétracte en un étrange ballet. On dirait un courant marin soigneusement orchestré par une main divine.
Thomas Van Hecke se trouve au centre de cette danse. Seulement vêtu d'un pantalon. Ses mouvements sont lents, maîtrisés et son visage affiche une concentration que rien ne pourrait briser.
Silencieuse comme une ombre, je descends quelques mètres de l'échelle de cordes et me penche pour l'étudier de plus près.
La peau blanche de son dos semble presque luire sous les lueurs de l'aube et même à cette distance je parviens à discerner ses muscles secs se tendre sous l'effort. Il bouge avec une lente grâce, déploie ses bras, les ramène, puis change d'appuis tour à tour.
La magie semble suivre ses mouvements, comme un serpent hypnotisé par un joueur de flûte. Elle s'écarte, puis s'approche, et pendant un instant, j'ai l'impression bizarre qu'elle n'est plus cette énergie malsaine et chaotique qui bourdonnait à mes oreilles. Elle parait adoucie, fluide, comme une eau paisible.
J'admire plusieurs minutes durant la maîtrise déployée par le jeune homme. Il a beau être à demi-nu, il ne semble pas souffrir de la fraîcheur. On dirait même qu'il a chaud à en croire la transpiration qui fait briller sa peau.
Mon regard s'attarde sur son torse et je me sens rougir malgré moi.
Je me maudis intérieurement. Ce n'est pourtant pas la première fois que j'aperçois un corps masculin, c'est même inévitable dans la promiscuité de ce navire. Je ne devrais même pas m'en émouvoir.
Je me fustige en secouant la tête. On dirait une midinette en pleine pâmoison. Je suis décidément ridicule.
Au moment où je me fais cette réflexion, Thomas se retourne et lève les yeux vers moi.
Par tous les saints.
Nous nous fixons plusieurs secondes, immobiles et aussi surpris l'un que l'autre. Lorsque je crois que je vais mourir de honte, un sourire suffisant étire ses lèvres et il effectue une brève révérence, comme un artiste sur le point de quitter la scène.
Je me détourne, les joues en feu, et fait mine d'être absorbée par les enfléchures du hauban, comme si j'étais bien trop occupée pour lui prêter attention. Lorsqu'il se détourne, je m'empresse de grimper le plus haut possible pour me mettre hors de vue.
***
— Louis ! hurle la voix de Joseph depuis le mat d'artimon.
Je tourne la tête surprise, et manque perdre l'équilibre. Je me rattrape de justesse à la drisse qui permet de hisser la vergue.
— Sur le pont ! C'est le cap'taine qui demande.
Je lève mon pouce et m'empresse de terminer ma manœuvre.
Je me penche par-dessus la hune, une main agrippée à l'un des étais qui maintiennent le mât.
— C'est bon ?
En contre-bas, Brébant, arc-bouté sur l'écoute hoche la tête et fixe l'amure de la voile que nous venons d'ajuster.
Je m'empresse de dévaler les haubans pour rejoindre le pont. L'équipage s'amasse déjà près du gaillard d'arrière où le capitaine, juché sur la dunette nous observe. Leroy se tient derrière lui, le visage grave et les bras croisé dans le dos.
Je cherche malgré moi la silhouette noire de Van Hecke sans la trouver. Il est peut-être encore au chevet de Jacques, pour changer le pansement à sa tête et vérifier la guérison de sa jambe.
Pauvre Jacques. Rester enfermé dans la soute le tue à petit feu. Sans compter que les visites de Thomas le mettent à cran et font fuir tout le monde.
Plusieurs secondes s'écoulent mais le capitaine ne semble pas vouloir prendre la parole. Des chuchotements parcourent les rangs autour de moi.
— Qu'est-c'qui s'passe ?
— On annule l'expédition ?
— Et nos gages ? on les aura quand même alors ?
— Taisez-vous imbéciles !
Poret lève une main pour réclamer l'attention et le silence retombe.
— Comme vous le savez, la tempête que nous avons essuyée il y a quelques jours a causé de nombreux dégâts matériels et une blessure importante pour un de nos gabier.
Les hommes hochent gravement la tête. Joseph a beau être un escroc patenté, sa bonne humeur est appréciée à bord. Même Brébant, qui n'aime personne par principe se montre moins bougon lorsque Jacques est dans les parages. C'est dire.
— En conséquence, le lieutenant Leroy et moi avons pris une importante décision concernant notre trajectoire.
Cette fois un silence de plomb s'abat sur le pont. Tout le monde tend l'oreille, suspendu aux lèvres du capitaine.
—... Notre première escale aura lieu à Reykjavik, en Islande et non à Nuuk, sur les terres danoises du Groenland, comme initialement prévu.
Des murmures approbateurs saluent cette annonce. Mes yeux brillent et ma poitrine se gonfle d'impatience comme une voile sous le vent.
L’Islande. Une terre qui me paraissait si lointaine, faite de glace et de volcans. Les feuilletons de Jules Vernes me reviennent en tête en un éclair, les voyages au centre de la terre, les expéditions sur des terres de neige et de glace...
Puis on entend un claquement irrégulier en provenance de la soute. Lorsque Jacques émerge des entrailles du bateau, appuyé sur deux béquilles de fortunes, le visage rougi par l'effort tout le monde se fige, stupéfait. Thomas Van Hecke, le précède, un bras derrière lui au cas où le gabier basculerait en arrière.
L'idée me fait ricaner. Un gabier tel que Jacques possède un sens de l'équilibre à toute épreuve. Il ne faut rien de moins qu'une tempête pour le faire trébucher.
— Qu'est-c'que vous r'gardez comme ça ? lance Jacques avec un sourire en coin.
Des vivas explosent parmi l'équipage et pour une fois, personne ne prête attention au magicien. Les matelots se presse autour de Jacques pour lui assener de grandes claques dans le dos, ravis de le voir sur pied.
Je souris en retrait. J'attends que la cohue cesse autour de lui pour aller à mon tour lui dire un mot. Quelqu'un se glisse alors à mes côtés et j'entends le murmure de la magie s'intensifier en même temps qu'un frisson dresse chaque poil de mes bras. Je n'ai même pas besoin de me retourner.
— Je ne vous ai pas remercié de m'avoir sauvé cette nuit-là, dit-il d'une voix grave.
— Ce n'était pas nécessaire, je rétorque sans le regarder. Nous sommes quittes.
La magie s'agite à nos pieds. Je dois être nerveuse.
— Cette escale est votre chance, murmure-t-il.
— Ma chance ?
— Reykjavik est petite mais possède un port. Vous trouverez sûrement un navire en direction d'Amsterdam, Hambourg ou Copenhague... De là, il vous sera aisé de rallier les côtes françaises. Ou Londres, si vous préférez.
Retourner en France. L'idée m'était presque sortie de la tête et me semble un projet si lointain. Je me suis peu à peu accoutumée à la vie sur le bateau.
— Nous verrons, dis-je évasivement.
— Vous n'êtes pas à votre place parmi ces hommes. Ni sur ce bateau.
Je plisse le front, vexée.
— Dis celui qui a failli se faire jeter par-dessus bord lors de la dernière tempête.
Je lui jette un regard de biais et le vois faire la moue.
— Vous n'aurez pas toujours de la chance, mademoiselle.
— Ici, je m'appelle Louis.
— Continuez de mentir à la terre entière, cela ne change rien à ce que vous êtes.
Je reste coite, estomaquée, sans savoir quoi répliquer. La colère me fait serrer les poings un peu plus fort. Sur un bref salut il se détourne.
— Louis ! beugle Jacques qui vient de m'apercevoir. Alors on dit plus bonjour ? Tu m'snob maint'nant qu't'es gabier ?
Sa bonne humeur m'arrache un sourire crispé et je m'avance pour lui donner une franche accolade qu'il me rend tant bien que mal, gêné par ses béquilles.
Thomas Van Hecke a parfaitement tort. Je peux être qui je veux. Il ne m'a pas fallu plus de trois semaines pour intégrer un équipage, et être considérée comme l'un des leurs.
— Terre ! hurle alors un matelot accoudé sur le bastingage en pointant l'horizon.
Je pousse un cri de joie à l'unisson de mes camarades. L'euphorie générale coule dans mes veines comme du miel et je repousse les mots du magicien.
— Gabiers aux manœuvres ! lance Leroy depuis la dunette.
Tout l'équipage se disperse sur le pont. Je m'élance avec les autres dans les cordages et grimpe vers les voiles. Un des matelots entonne un chant de halage pour donner le rythme et nous reprenons en cœur le refrain.
Je me suis rarement sentie aussi bien, à ma place, libre de mes mouvements. Pourtant la voix de Thomas s'obstine à la marge de mon esprit, comme une rengaine obsédante.
Continuez de mentir à la terre entière, cela ne change rien à ce que vous êtes.
 Language : English
Language : English